Enfants de gouttières - Roman inédit

Avec l'aimable autorisation de l'auteur
Adaptation littéraire du scénario éponyme déposé à la SACD en 2001
© 2011 - Rémi Le Mazilier
Tous droits réservés
Épisode 1
Le petit garçon aux cheveux noir de jais
Le matin du 1er octobre 1957, un mardi, mon grand père Joseph m’amenait à la pension Saint Christophe (Christophe est aussi mon prénom !), à B..., bourgade du bord du Rhône, voisine de ma ville natale ; il portait ma valise d’interne et un sac de toile cylindrique, qu’on appelait « sac de plage », contenant une paire de draps. Dix autres garçons de 8 à 14 ans se regroupaient avec les personnes qui les accompagnaient... Il n’y avait qu’un père et qu’une seule mère ; les grands parents et un oncle remplaçaient les géniteurs, occupés ou absents de la vie de ces enfants. Tous, nous étions des enfants de familles « à problèmes ». J’avais 10 ans depuis six mois. C’était ma quatrième rentrée des classes dans cette vieille usine désaffectée depuis des lustres - une ancienne verrerie -, d’où pointait vers le ciel une cheminée en briques rouges, dont la hauteur, à nous enfants, paraissait vertigineuse. L’école appartenait à l’évêché. Elle comptait trois classes, du premier cours élémentaire à la classe du certificat d’études ; plusieurs niveaux étaient donc dispensés dans chacune des classes. Au premier étage de la grande et plutôt sinistre bâtisse, quatre petits dortoirs pouvant héberger douze pensionnaires pour quelque quatre-vingts écoliers. La moitié des élèves étaient demi-pensionnaires et emplissaient le réfectoire à midi - ruche bouillonnante d’enfance et d'insouciance.
Au rez-de-chaussée, face à la cour rectangulaire, les salles de classes...
Le personnel était laïque. Il comprenait deux instituteurs (dont le directeur) et une institutrice pour l’enseignement ; la femme du directeur, exécrable, et sa sœur, une vieille fille très gentille, aux cheveux lissé avec chignon, pas encore blancs et plus vraiment gris, douce comme une grand-mère, s’occupaient de l’intendance, assistées par « M. Lucien », l’homme à tout faire de la maison, également projectionniste de la salle paroissiale contiguë à la cour de l’école. L’un des instits faisait office de maître d’internat. Durant cette sombre histoire, c’est autour de lui qu’allait graviter toute la marmaille en mal d’affection. Pour autant qu’il me souvienne, et pour des raisons que je n’ai jamais comprises, la totalité des enseignants, à part M. Lepic puisqu’il était le directeur, changeait à chaque début d'année scolaire. J’avais donc déjà eu à Saint Christophe deux « maîtres » et une « maîtresse », tous charmants - et dont j’avais été le chouchou de chacun... L’un d’eux, M. Lebrun, me caressait le ventre sous le préau et sous la chemise, mais avec une tendresse qui ne violait pas le dessous de la ceinture. Il faut dire que depuis mon entrée en CE1, je n’avais jamais cessé d’être le meilleur de la classe, « le premier » au classement, mois après mois. Le drame qui allait se dérouler en cette nouvelle année scolaire devait me toucher particulièrement parce que, là encore, j’allais devenir rapidement le préféré de l’instit qui devait en être la première victime... Lui, il ne m’a jamais caressé le ventre, ou n’en a pas eu le temps, mais sa bienveillance à mon endroit, cette sorte d'admiration qu’il me portait, sa gentillesse naturelle à l’égard de tous les écoliers, qui n’empêchait pas une sévérité juste, allait vite m’impressionner favorablement.
Un beau ciel bleu se mariait au feuillage jauni et éclairci des deux platanes et des deux tilleuls qui agrémentaient la cour. Le portail métallique, un portail de cour d’usine à la peinture gris clair défraîchie et fortement écaillée, s’ouvrait à droite d’une sorte de remise d’où partait la cheminée. Le mur d’enceinte était construit de galets du Rhône et donnait, au sud, sur une ruelle sinistre avec peu de maisons et beaucoup de murs décrépis ; c’est dans cette voie aussi grise qu’un cimetière que se trouvait l’entrée de l’institution. Quand on pénétrait dans la cour, passée la tôle qui chapeautait le portail et sur laquelle était peints les mots « École libre de garçons Saint Christophe », le local-débarras ouvrait sa gueule peu accueillante sur la gauche et sentait la poussière et l’humidité, tandis que l’interminable alignement des WC d’écoliers occupait la droite jusqu’à jouxter le préau côté est. La façade du bâtiment, toute de briques rouges, montée d’un étage, exhibait une suite de vitrages d’usine, rectangles verticaux de vitres séparées par de minces cadres métalliques. Le toit était de tuiles romaines, dites « canal », ces belles tuiles toute rondes qui font le charme des toitures provençales. Une statue blanchâtre, de la taille d’un enfant de cinq ans, trônait sur un socle en saillie suspendu à la façade : elle représentait le bon Saint Christophe tenant un garçonnet souriant dans ses bras. Le personnage, que je supposais fait de plâtre, non peint, m’avait toujours paru sympathique et le sourire du petit garçon rassurant. J’ai toujours été étonné de ce que de petits détails de statues, pourtant éloignées, pouvaient accrocher mon regard : ici, c’était le visage radieux du gamin. Très croyant, nourri par mon père et ma grand-mère du culte des saints, cette statue rigide me semblait un peu vivante, magique, détentrice d’une présence surnaturelle mais amicale. Et puis, c’était la représentation de « mon » saint ! Avec le crucifix accroché au-dessus des tableaux noirs des salles de classes et du réfectoire ainsi que dans chacun des petits dortoirs, cette statue bienveillante qui habitait la façade constituait la seule marque religieuse de l’établissement. Un bâtiment qui me paraissait imposant, haut de deux étages, barrait le côté nord de la cour (à gauche donc quand on franchissait le portail), non dévolu à l’école ; il était vide excepté le rez-de-chaussée transformé en salle de cinéma paroissiale qui portait pour nom « Le Familial ». Un goudron fané, grisonnant, permettait aux gamins de dessiner des « marelles » sur le sol. L’asphalte usé, tanné par le temps, facilitait les parties de billes et le jeu d’osselets, qui se partageaient avec la marelle les faveurs des écoliers. Un escalier métallique abrupt partait du fond, à droite, pour grimper à l’étage. Il aboutissait à un balcon soutenu par des piliers de fer guère plus gros qu’un bras d’homme, peints en noir, lustrés par les ascensions des gamins qui se plaisaient à les utiliser comme une corde de gymnastique. J’étais le plus fidèle grimpeur de ses chandelles de métal, froides l’hiver et chaudes l’été, curieusement odorantes - une odeur de métal et de rouille qui m'envoûtait. C’est en m’enlaçant autour d’elles que j’ai éprouvé pour les premières fois d’étranges et délicieuses sensations au bas de mon ventre, en toute innocence. La porte épaisse de l’étage donnait sur les parties habitées par le personnel permanent et les enfants, la cuisine et le réfectoire.
Cet escalier en avait vu des galoches lui écraser ses marches de tôle gaufrée !
Les salles de classes s’alignaient au rez-de-chaussée, au nord de la cour, chacune des portes vitrées étant encadrées de ces baies d’usine dont j’ai parlées plus haut. Un trottoir étroit bordait le bâtiment. A mi-parcours de ce trottoir se dressait un tuyau métallique muni d’un robinet où chacun pouvait s’abreuver, abouché sans dégoût à l'orifice de cuivre. La quatrième porte était située sous le préau ; elle donnait dans un débarras obscur et poussiéreux où s’amoncelait un fatras de bureaux d’écoliers, de bancs et de vieilles armoires, liés entre eux par d’énormes toiles d’araignées alourdies par la poussière.
Deux gros piliers carrés, en briques rouges, portaient, côté est, le toit du préau que soutenait une charpente à l’ancienne. Large et spacieux, ce préau a abrité, par temps de pluie, de nombreuses et interminables parties de cartes ou d’osselets. Sombre et tristounet, plutôt froid, le préau n’était guère fréquenté par temps sec, même l’hiver. La pièce noire et lugubre, visible à travers les vitres crasseuses de sa porte, dissuadait les enfants de séjourner à proximité ; seule la multitude des écoliers, bavards et remuants, rendait ce préau supportable.
Je remarquai, tout au-dessus de cette cour qui allait voir nos jeux insouciants et le climax de notre drame, un chat noir tassé nonchalamment sur le creux d'un chéneau, au plus haut des toitures, qui semblait plonger son regard curieux sur la gent humaine qui s'agitait...
Une dame d’un certain âge habillée en fausse bourgeoise - une de ces femmes de milieu ouvrier qui se façonnaient une image de classe moyenne en certaines occasions -, passa le portail avec un garçonnet qu’elle tenait par la main. J’estimais qu’il avait sept ans. Petit et fluet, la figure fine, rose, aux cheveux plats et lisses noir de jais, deux yeux verts brillants comme des pépites, il était vêtu d’une veste sombre bien taillée ouverte sur une chemise aux motifs imprimés et d'une culotte noire très courte portée par des bretelles ; ses socquettes blanches enveloppaient des chevilles de poupon au-dessus de sandalettes marron. Des larmes mouillaient ses yeux. Comme beaucoup d’autres camarades, j’étais venu à l’école vêtu d’une blouse que j’étrennais, grise et qui sentait le coton neuf, rêche de ne jamais avoir servi. Une multitude de blouses, grises pour la plupart mais avec des tons différents, des noires comme l’anthracite, des bleus comme les uniformes des soldats d’autrefois ou celui, plus sombre, des combinaisons d’ouvriers, couraient en tout sens dans la grande cour, gesticulant, criant, riant... Des blouses se battaient ou faisaient semblant. Des claquements de semelles de sandalettes ou de godillots résonnaient de concert. Nous étions nombreux à porter des culottes courtes en tissu plus ou moins épais, s'arrêtant au-dessus du genoux ou remontant jusqu'au haut des cuisses. Des garçons portaient encore le veston. Les cartables (qui n’avaient plus de bretelles à cette époque - va-t-on savoir pourquoi), s’entassaient au bas des murs, jetés là négligemment ou posés sagement par quelque écolier ordonné. Un tas de cartables ici, près de la grande cheminée, quelques cartables là, au milieu de la cour, abandonnés par leurs propriétaires.
Les familles des pensionnaires, ou plutôt leurs « accompagnateurs », étaient regroupées non loin du portail et à proximité de l’alignement des cabinets, lesquels étaient encore d’une propreté sans faille et exempts d’odeurs acides ! Les marmots destinés à l’internat se tenaient près des leurs ou du leur. Les valises et les sacs patientaient à même le sol entre les adultes et les enfants. Moi, je tenais mon cartable à la main car il était neuf lui aussi et j’aimais pétrir sa poignée de cuir. Mon grand-père Joseph rongeait son frein, droit comme au garde à vous, digne dans son unique costume, celui des dimanches, parfaitement coiffé, la raie bien sur le côté et les cheveux fixés avec un peu de Brillantine, couvert d’un béret ; il toussait de temps en temps, se raclant la gorge si possible avec discrétion car il souffrait d’une sorte de laryngite chronique probablement due au tabac et qui faisait souvent dire à ma grand-mère : « Joseph ! arrête ! » sur un ton agacé. Je tenais un petit manteau de drap beige sur un bras. Devant l’assemblée des internes et leurs protecteurs, l’ensemble du personnel d’internat se campait sur une ligne ; M. Lepic, le directeur, se tenait au milieu, flanqué de droite et de gauche de la redoutée et détestée « directrice », de « l’intendante » (sa sœur, la grand-mère gâteau de service) avec son sempiternel sourire, et de « M. Régis », le nouveau surveillant d’internat qui devait aussi être mon maître d’école.
Le directeur prit la parole :
- Chers parents, certains d’entre vous connaissent déjà notre établissement, modeste dans sa structure, certes, mais qui a su éduquer et entourer les enfants qui lui ont été confiés par le passé... Nous savons que vous revenez nous placer vos chers petits avec la même confiance et la même certitude d’avoir bien choisi ce qui leur convient... Quant à vous, chers parents qui nous amenez de nouveaux élèves, soyez assurés que le personnel chargé de l’intendance, en parfaite harmonie avec l’équipe enseignante, saura à la hauteur des objectifs de l’École Saint Christophe : les éduquer et les aider à grandir ! L’école saint Christophe est une grande famille : vos enfants s’y détendront aux moments de loisir avec la complicité du personnel. Vous savez, je ne fais que vous le rappeler, que chaque jeudi, une sortie sera effectuée dans la nature ou, si le temps ne le permet pas, des activités ludiques ou même peut-être le cinéma leur seront proposés. Marie-Thérèse, la sœur de mon épouse, ainsi que le maître d’internat, m’accompagnent dans ces sorties et activités.
Puis il se tourna vers ses côtés :
- Mais le moment est venu de vous présenter Mme Lepic donc, mon épouse (petit sourire de convenance aussi désagréable qu’inutile esquissé par ladite épouse) et enfin M. Régis, notre surveillant d’internat également maître d’école en charge des CM1/CM2.
L’homme baissa un peu la tête pour saluer avec un sourire discret mais authentique qui renvoyait au cimetière celui de la pseudo directrice. Déjà, ce nouveau maître plaisait aux familles et aux enfants; j’en avais la conviction immédiate. Il était grand, mince, le visage creusé orné d’une belle moustache bien taillée, sous une chevelure châtain foncé saine et ondulée. Il était en blouse grise, une blouse neuve, ceint à la taille, pieds nus dans des sandalettes.
- A présente, conclut M. Lepic, je vous invite à suivre mon épouse ainsi que M. Régis à l’étage, pour accéder aux dortoirs où vous laisserez les bagages des enfants. Vous visiterez aussi le réfectoire.
M. Lepic restait en bas pour accueillir les autres élèves et assumer ses fonctions auprès des familles. L’institutrice surveillait les jeux des enfants.
Une petite voix larmoyante monta dans l’assistance. « Je ne veux pas rester en pension ! » suppliait le petit garçon aux cheveux de jais. L’enfant se blottissait comme un bébé dans la jupe de la femme qui l’accompagnait. Ce faisant, il portait son regard anxieux et quelque peu terrorisé sur la figure de sorcière de la « directrice » (nous l’appelleront désormais comme cela bien qu'elle n'avait aucun pouvoir directionnel ou aussi « la Lepic », comme c’était d’usage chez les enfants de l’école). La mégère toisa le petit avec une étincelle diabolique qui eut pu foudroyer un bien plus grand ! La dame protectrice de l’enfant le serrait dans ses bras, un peu gênée, se voulant rassurante. « Tu seras bien ici... Tu auras des nouveaux amis... ». Le garçonnet pleurait comme pleure un tout petit qui ne veut pas franchir la porte de l’école maternelle. « Mémé ! Mémé ! » implorait-il en vain.
- On y va ! fit la directrice, désireuse de ne pas s’attarder sur ce caprice.
Le croisement de fers entre Mme Lepic et le petit garçon et à son désavantage me mit mal à l’aise. J’en détestais encore davantage la marâtre. Je savais qu’elle n’aimerait pas l’enfant et qu’elle ne lui épargnerait aucun supplice. J’avais moi-même connu ces tortures pour un motif que vous allez connaître un peu plus loin...
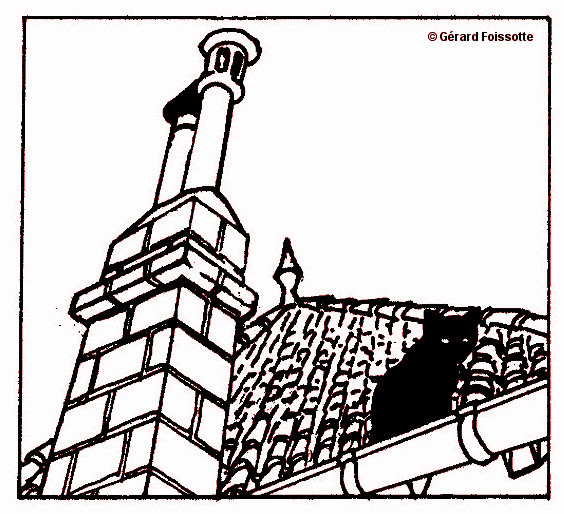
La vilaine femme grimpa l’escalier en tête de file, tandis que les marches d’acier vibraient sous les pas qui se succédaient de près entre le rez-de-chaussée et le balcon de l’étage. Le chat noir, venant d'en haut, sauta sur la première marche puis descendit l'escalier quatre à quatre, zigzaguant entre les jambes. La Lepic manifesta son hostilité à l’animal qui l'effleurait. Le « chat de M. Lucien » (ainsi appelé car le bonhomme l’avait en quelque sorte adopté, un beau jour où il apparut dans la cour) n’était pas en odeur de sainteté chez Mme Lepic ! D’autant que, bien qu'un tantinet bigote, elle s’avérait aussi très superstitieuse (un chat noir, vous pensez !)... Mais son animosité, à cet instant, elle la réservait plutôt au petit garçon aux cheveux de jais. Tout en montant, la directrice lui lançait des regards éclairs par derrière ses épaules, cherchant à le viser et à l’atteindre, comme pour lui signifier qu’avec elle, assurément, il allait en baver... Je pensais : « Comment peut-on ainsi être femme et haïr les petits ? ». De plus, notre sale bonne femme était mère ! Et je savais qu’elle adorait son grand fils, un sympathique garçon au demeurant qui, à vingt ans, effectuait son service militaire comme engagé dans un régiment de parachutistes, les fameux « bérets rouges » si craints, disait-on, des « fellagas » d’Algérie. Jean-Baptiste, quand il venait en permission, était reçu comme un dieu et un futur héros par le couple Lepic. Il descendait dans la cour parler avec les mômes, leur racontait ses exploits de soldats tel un grand frère aventurier...
Probablement que Mme Lepic était de ces femmes qui étaient capables de n’aimer qu’un enfant : leur unique !
A suivre...
Genèse et présentation du roman
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 35 autres membres


